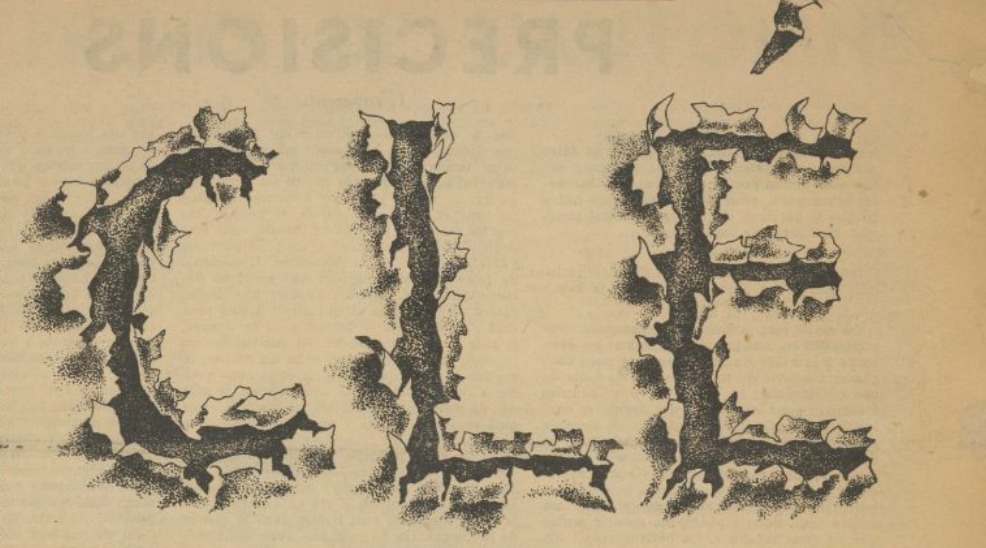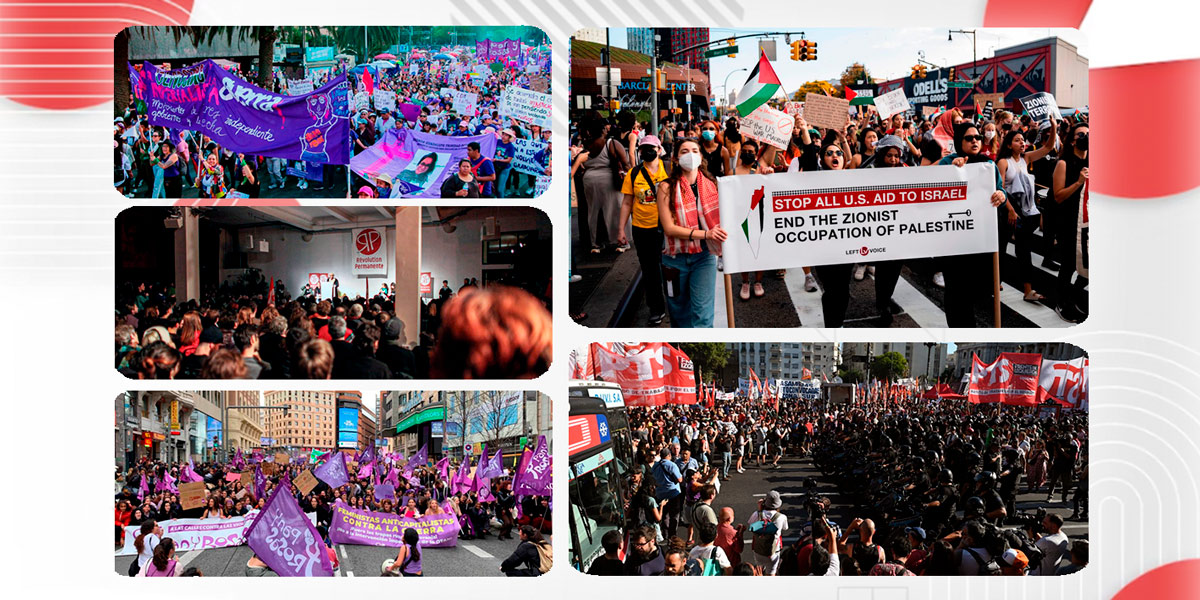En 1789 le « peuple » était « nation ». Mais il y a eu un avant, et nous sommes bien après
Sapir est-il la preuve, comme le réaffirme sans grand ménagement J.-L. Amselle dans une récente tribune de Libération, qu’aucun bon souverainisme ne serait possible ? Contre cette idée commence à se re-développer l’argument selon lequel un « souverainisme de gauche » véritable serait irréductiblement antagonique aux souverainisme de droite ou d’extrême-droite, saurait se protéger de toute tentation nationaliste, et même justifier certaines stratégies de la gauche radicale (entre autres celle de l’Unité Populaire grecque), en vertu de trois piliers. D’une part, la convocation d’un contrepoint internationaliste, d’un appel aux peuples et gauches radicales d’Europe et d’ailleurs. Ensuite, ce qui a fait spécifiquement l’objet du texte de Frédéric Lordon de fin août, « Clarté », et qui va nous intéresser en priorité ici, la clarification « à gauche, et à gauche seulement » des idées de nation et de souveraineté. Enfin, sur le terrain de la réalité immédiate, une sortie du « carcan de l’euro », pour la Grèce, pourrait permettre de relancer une dynamique populaire en vue d’une nouvelle étape émancipatrice contre le capitalisme. Dans cette configuration, un souverainisme de gauche réactualisé constituerait une option stratégico-idéologique viable dans une situation caractérisée, emblématiquement, par l’incompatibilité de toute dynamique progressiste en Grèce avec, dorénavant, son maintien dans l’eurozone.
F. Lordon déplore que les signifiants « nation » « souveraineté » soient, de longue date, devenus un patrimoine purement droitier, abandonné par la gauche, et milite pour leur réappropriation, et il renvoie à Robespierre et au modèle de la souveraineté nationale-populaire de 1789. Effectivement, avec 1789 la « nation » surgit, dans l’ensemble, comme un véritable opérateur politique et stratégique : celui, préparé par les Lumières et sur fond d’accumulation primitive, de l’unification égalitaire d’un peuple anciennement clivé en ordres inégaux par nature. Oui l’équation « peuple = nation », dans ce contexte historique, précapitaliste et anti-féodal, fondateur d’une république à vocation universaliste, était alors clairement une idée pas seulement « radicalement de gauche », mais révolutionnaire, donnant sa formule à un sujet politique inédit prenant en main et à une échelle de masse, contre les archaïsmes d’un ancien régime décomposé, son destin.
Mais c’est bien dans l’ensemble seulement que l’on peut dire ça. Ce peuple-nation n’est certes pas l’indicateur mythifié d’une nouvelle réalité transcendante ou substantielle, mais dans le détail des présupposés naturalistes (voir Sieyès par exemple) ou d’attendus déistes (Robespierre himself) sont ici ou là explicites. A l’opposé (dans la théorie, comme dans la lutte politique qui verra, notamment, l’écrasement de la conjuration des égaux), émerge déjà le déterminant de classe au sein du « peuple », d’abord avec les sans-culottes, comme l’a analysé Daniel Guérin dans Bourgeois et bras nus. Autrement dit, la réalité du « peuple-nation » de 1789 et ensuite, par-delà sa principale dynamique historique, était loin d’être homogène, mais au contraire traversée de lignes politiques distinctes, qui sont allées en s’écartelant au cours du XIXe siècle. D’un côté, dans le sillage des appareillages idéologiques (allemand comme français), de la contre-révolution, par le développement progressif d’un nationalisme droitier au spectre large, de facture républicaine ou royaliste, avec toutes sortes de variantes intermédiaires.
Ce passage progressif à droite de la « nation » au cours du XIXe siècle dans les pays capitalistes avancés n’est pas le tout de l’affaire. En effet l’écartèlement du « peuple-nation » s’est opéré aussi, à l’autre extrêmité de l’échiquier, sous la tension croissante, proportionnée au développement du mouvement ouvrier, entre ce « peuple » à la république devenu formelle et caution explicite du pouvoir bourgeois dès 1848, et le prolétariat grondant. Tension qui s’est corrélativement accrue aussi entre les échelons national et international, l’internationalisme communiste du Manifeste, et la nouvelle délimitation selon laquelle « les prolétaires n’ont pas de patrie », dessinant une figure antagonique de la liberté populaire. Autrement dit on ne peut mettre entre parenthèses la différence historique énorme qu’il y a entre 1789 et la seconde moitié du XIXe siècle, puis avec le tournant du XXe, période où les coordonnées de la droite et de la gauche avaient déjà bougé par rapport à ce qu’elles étaient antérieurement. La droite nationale-populiste, qu’elle fût républicaine, monarchiste, voire pré-fasciste s’était déjà appropriée certains ítems de la gauche, en l’occurrence la question sociale. De l’autre côté, dès avant et encore plus après la révolution russe, la gauche elle-même était alors pleinement polarisée par l’internationalisme porté par un mouvement ouvrier dorénavant bien organisé au-delà des frontières.
Enfin, on ne peut gommer les évolutions qu’il y a eu entre ce début du XXe et aujourd’hui. Non seulement nous ne luttons pas contre le féodalisme, mais nous ne luttons pas non plus contre un capitalisme débutant l’internationalisation du processus productif, et expérimentant, deux guerres mondiales à l’appui, les vertus du poison nationaliste comme arme de destruction massive du prolétariat simultanément engendré à la même échelle. Aujourd’hui que se sont généralisés et enracinés les mécanismes centraux de cet impérialisme, et en particulier la transnationalisation des grandes entreprises, nous constatons à quel point l’Etat-nation n’a pas disparu, mais au contraire voit son importance démultipliée, outil central des bourgeoisies nationales pour atteindre leurs objectifs dans le cadre d’une concurrence particulièrement exacerbée, y compris dans le cadre d’accords ou d’espaces internationaux. Cela pour dire combien la réalité de la « nation » et de la « souveraineté » a bien changé depuis 1789, et qu’il est erroné de retourner aux origines de ces signifiants si c’est pour les transposer trop vite sur la situation actuelle.
Concernant la souveraineté d’autre part, l’échelle nationale est loin d’être la seule pertinente pour la penser. Celle-ci s’est toujours déployée aussi dans le registre de l’autonomie locale, et pas seulement dans les grèves et manifestations d’aujourd’hui. Max Weber – et cela dit sans être un weberien pratiquant – le disait dans La ville, la « citoyenneté populaire » s’est constituée au long du processus pré-moderne d’abord à l’échelon citadin, voire sous forme de « communes autonomes », avant que le « citoyen » ne soit façonné en bourgeois consommé. Mais bien avant cela, l’aspiration « démo-cratique », qui est le fond de l’affaire, était déjà le nœud vital de la « stasis » (guerre civile) antique, dans le cadre de cités-Etats qui n’avaient rien à voir ni avec « l’Etat-nation ». Pourtant, cette revendication démo-cratique, non pas seulement celle de la glorieuse Athènes de Périclès, mais avant cela celle de la plèbe qui s’affrontait à l’aristocratie foncière et à ses pouvoirs politiques exorbitants, était déjà une aspiration (certes ni codifiée, ni ritualisée, ni même encore conceptualisée, et encore moins électoralisée) objectivement puissante à la souveraineté, c’est-à-dire à la détention ou du moins à l’exercice légitime, et suffisant pour préserver ses intérêts de proto-classe, de l’autorité politique.
En contrepoint, preuve par les effets cette fois, il n’y a pas besoin d’aller jusqu’à Sapir pour savoir que le souverainisme quel qu’il soit est extrêmement glissant, et a besoin d’anticorps sévères pour ne pas partir avec le reflux. Entre la version de gauche-radicale et les version réactionnaires, s’intercalent toutes sortes de variations qui montre que le venin nationaliste qui a gangrené les directions historiques du mouvement ouvrier, depuis la IIe Internationale passée avec armes et bagages à la puanteur de 14-18, le stalinisme, et la plupart des social-démocraties, est loin d’être un simple souvenir seulement marqué à droite. Les diatribes contre le « poison allemand » d’un Mélenchon au national-républicanisme hareng-bismarckien indécrottable, lui qui avait tant « confiance » en Tsipras il y a peu, devraient suffire à inquiéter – et aucun de ceux qui s’affichent auprès de lui ne peuvent en sortir indemnes. L’alliance de Tsipras avec les souverainistes d’ANEL quant à elle, est suffisamment récente pour qu’on ne l’oublie pas.
Souveraineté et point de vue de classe
D’un point de vue marxiste, le centre de gravité de la question de la souveraineté est évidemment celui des rapports de classes, et le concept associé de pouvoir populaire, celui de démocratie prolétarienne. Mais cela ne signifie nullement qu’il faille abandonner le terrain national. S’il n’est pas l’unique cadre d’expression et de combat populaires, ce n’est pas pour autant un simple cadre parmi d’autres, parce que le régime de l’Etat-nation reste encore aujourd’hui un pilier absolument déterminant de l’édifice politique sur toute la planète, et en l’occurrence dans l’Union Européenne, dont l’actualité montre chaque jour (par-delà la fonction de coordination du capital européen, sous l’égide des bourgeoisies les plus fortes, qui lui est dévolue depuis ses fondations, et la logique génétiquement impérialiste dont elle a révélé face à la Grèce le brutalité infinie) combien entre ces bourgeoisies nationales persistent de profondes tensions concurrentielles, d’intérêts antagoniques, et de choix, ou du moins de velléités politiques divergentes.
Pour ces raisons, du point de vue stratégique, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit ici, le problème véritable ne se situe ni dans la « nation » ni dans la « souveraineté », il est celui des conditions sous lesquelles un combat façonné par les coordonnées état-nationales peut réellement servir de point d’appui ou de vecteur progressiste à une politique révolutionnaire conséquente, une politique inconditionnelle des et pour les millions d’exploités, d’opprimés et de pauvres qui meurent à l’usine, ou à trois ans dans la marée sanglante des migrations forcées. C’est cette classe seule qui pourra, en tant que classe capable d’incarner et de porter les espoirs de tous les secteurs opprimés par le capital, disputer du même mouvement (logique permanentiste), et non après (funeste logique étapiste déconnectant combat « démocratique » et combat pour le pouvoir des travailleurs), autant aux bourgeoisies nationales qu’à l’UE en l’espèce, l’exercice du véritable pouvoir, économico-politique. Sans une telle politique, aucune revendication de « démocratie », ni aucune revendication de « souveraineté », ne sortiront par miracle des ornières de la noyade dans les urnes et, tôt ou tard, de politiques nécessairement encastrées dans les institutions d’un Etat qui restera antisocial et antiouvrier, tant qu’il ne sera pas affronté comme tel avec les moyens requis.
Dans un article précédent nous revenions sur certaines théories de la démocratie radicale, pointant que, aussi opposées qu’elles peuvent être à la pseudo-démocratie de l’ordre bourgeois, elle font toutes l’impasse sur les conditions de leur propre cohérence, refusant de s’affronter à la question du pouvoir et d’une transition révolutionnaire non réduite à de simple incantations. D’où leur conformation néo-utopiste, laissant la place libre à toutes les illusions néo-réformistes comme celles qui ont, de fait, grandement prospéré autour de Syriza et de Podemos. Un néo-souverainisme de gauche radical, aussi légitime et importante que soit la clarification sur les signifiants, ne peut que s’inscrire dans cette lignée, pour la raison qu’il oblitère à son tour le nécessaire centre de gravité que constitue la classe ouvrière, qui objectivement n’a jamais été plus importante et potentiellement dévastatrice pour le capital qu’aujourd’hui, aussi affaiblie soit-elle. Et toute approche sur cette affaire de la sortie ou non de l’euro, en particulier, restera nécessairement bancale et partielle tant qu’elle tournera le dos à cela.
Le véritable signifiant en dispute : l’internationalisme. « Pour quoi faire » et « avec qui » ?
Or F. Lordon termine son texte en condamnant, justement et avec raison, tout « fétichisme de la sortie » de l’euro qui serait oublieux de cette interrogation élémentaire, « la seule qui vaille » : sortir « pour quoi faire, et par suite avec qui ? – la seule qui ramène quelque clarté et fasse apercevoir certaines improbable alliances pour ce qu’elles sont : aberrantes, dévoyées et promises à la perdition, au double sens de l’égarement moral et de l’échec assuré ». Certes oui. Mais concrètement, peut-on alors, uniment en termes de programme, de stratégie et de tactique (approximativement ces « pour quoi faire » et « avec qui »), se limiter à dire que « La gauche est là. Même réduite au dernier degré de la minorité institutionnelle, elle ne mourra pas », comme il le propose en ouverture de sa conclusion, et se limiter à cette délimitation morale d’un côté, pragmatique de l’autre, sans autre considérant ? N’est-ce pas là un symptôme de la vaste zone d’ombre qui risque de continuer de plomber les débats sur la nécessaire recomposition de la gauche radicale, et pour le coup garantir « l’échec » de n’importe quelle option ?
Le défi n’est pas d’invoquer et convoquer la participation et la mobilisation populaires en général : qui ne le fait pas, jusqu’à Sapir y compris ? Il n’est pas non plus de se focaliser sur des solutions technico-économiques qui, pour être élaborées, tendront plus, à elles seules, à reconstituer et sauvegarder le capital national grec qu’autre chose. Le défi est de construire une politique centrée sur la mobilisation politique et économique quotidienne des masses, donc d’ordonner toute politique à l’effort pour diffuser et reconstruire au sein de la classe des exploités et des opprimés la compréhension de la nature du combat à mener. Donc de mener le combat dans les cadres d’organisations capables d’impulser en son sein de quoi redonner forme et sens à la colère et au désarroi qui, n’en doutons pas, vont grandir encore. C’est à une politique de ce genre que les révolutionnaires de tous pays, et en particulier en Europe, devraient aujourd’hui se consacrer.
Le mouvement ouvrier est en berne ? Soit. Et ? Alors l’effort pour le reconstruire, pour en recomposer les pointes avancées, de son propre sein et pas d’en haut ou par le simple biais d’appels au vote, doit justement être la priorité des priorités. Personne n’est le moins du monde dupe du « carcan de l’euro » pour reprendre la formule de S. Kouvélakis dans un récent entretien à L’humanité. Mais ce n’est pas du propagandisme ou de la complaisance dans une posture contestataire que de rappeler qu’être « réaliste », c’est aussi rappeler qu’en politique les raccourcis sont bien souvent de longs détours qui nous ramènent, plus fatigués encore, au point de départ. Et face à ces raccourcis, il est évident que notre hypothèse stratégique ne peut être celle d’un mythique grand soir international et simultané. F. Lordon s’attaquait explicitement dans un texte d’avril 2015 à ce qu’il appelait un « internationalisme imaginaire », « une certaine forme d’internationalisme révolutionnaire qui condamne d’emblée toute tentative dans un seul pays, et préfère attendre l’arme au pied la synchronisation planétaire de toutes les révoltes avant d’envisager quoi que ce soit. » Or il existe assurément, par-delà cette alternative, une conception de l’internationalisme fondée sur l’idée selon laquelle « La révolution socialiste commence sur le terrain national, se développe sur l’arène internationale et s’achève sur l’arène mondiale » (10ème thèse de Trotsky sur la révolution permanente). Et cette conception refuse corrélativement toute illusion sur une telle synchronisation, laquelle suppose un monde essentiellement homogène alors justement qu’il est marqué par un profond « développement inégal et combiné » ?
Le nécessaire affrontement avec l’état-nation, dont Marx avait bien compris depuis 1848 qu’il ne peut pas être repris aux capitalistes, mais qu’il doit être détruit, s’intègre dans un cadre stratégique plus large. C’est celui de la lutte pour l’émancipation du prolétariat en tant que classe, où chaque pas se mène en fonction de la double boussole de l’indispensable indépendance politique des exploités, soit dans le sens de leur auto-organisation, à l’égard de leurs exploiteurs, et d’une communauté d’intérêts entre ces mêmes exploités par-delà les frontières nationales. L’histoire des révolutions montre que l’effet contagion n’est pas une utopie et dans ce contexte tout combat contre la néocolonisation de la Grèce doit être mené en ayant comme horizon la perspective concrète d’une extension du soulèvement populaire à l’échelle du continent, et in fine de la construction d’une Europe socialiste des travailleurs.
La malhonnêteté consistant à assimiler souverainisme de gauche et souverainisme nationaliste et xénophobe est immense. Mais on risque très gros quand même à travailler sur ce terrain du souverainisme – y compris dans sa version plus rougie d’une « protectionnisme socialiste » antérieur à la prise du pouvoir – si l’on ne se dote pas des anticorps nécessaires. A lui seul, le monstre idéologique et politique du « socialisme dans un seul pays » devrait suffire à ré-instiller au moins ce que les juristes appellent le « doute raisonnable », et nous imposer, en ce centenaire de Zimmerwald et au cœur du scandale innommable des réfugiés, un internationalisme autrement plus ambitieux, en direction du peuple grec comme, à ce jour, des migrants, pour ne pas parler des autres. Il y a un siècle déjà le mouvement ouvrier s’était perdu, mené au casse-pipe par des directions politiques dégénérées. Les signataires de la conférence de Zimmerwald entendaient, face à cette faillite des organisations dominantes de la IIe Internationale, « ramener la classe ouvrière à sa mission historique ». Par-delà les coordonnées immédiates de la situation présente, n’est-ce pas là en vérité ce qui nous incombe véritablement aujourd’hui, sans se payer de mots, et avec toute la patience et la détermination requise ? « Commencer » sur le « terrain national », pour reprendre la formule de Trotsky, c’est ce qui exige le type d’organisation et de politique en direction des masses et de leur auto-organisation qui justement fait défaut aujourd’hui.
Donc oui, aucun "fétichisme de la sortie" de l’euro : au sens où on ne peut poser la question de l’euro indépendamment du changement des rapports capitalistes de production et de pouvoir au niveau national et international, puisque cela reviendrait à réduire ou centrer le programme révolutionnaire sur un simple changement monétaire. En résumé, le véritable problème stratégique, ce n’est pas l’euro, Ce sont les raccourcis. Et parmi eux le raccourci réformiste, fut-il radical, n’est pas le moins dangereux. Par l’illusion qu’il entretient toujours, même par la bande ou malgré lui, dans la possible conciliation entre des classes antagoniques, dans le possible usage réellement progressiste des institutions bourgeoises, et dans ces solutions étatistes et étapistes qui ont toujours laissé, tôt ou tard (et plus souvent tôt que tard) le peuple d’en bas caution, spectateur, puis pure et simple proie.