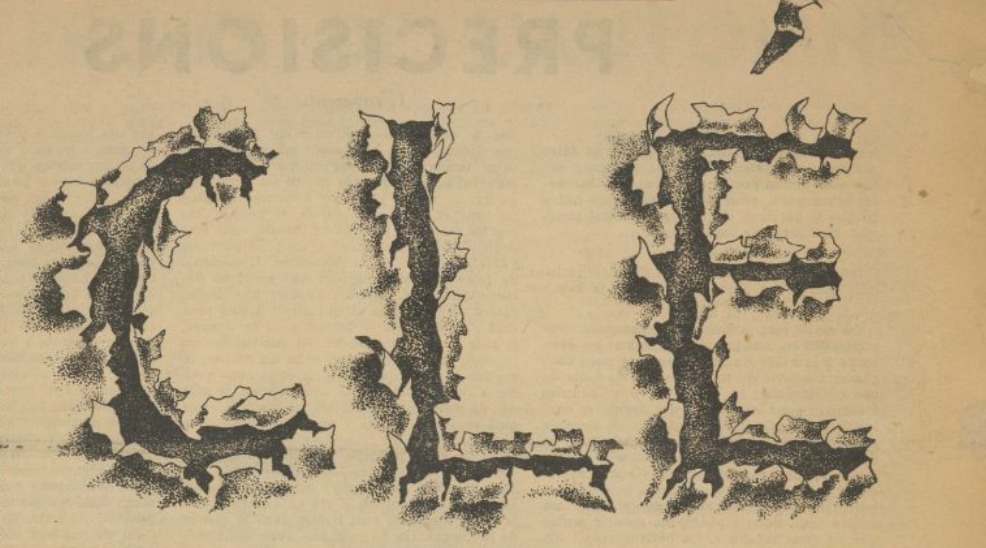Crédits Photo : Capture d’écran Bande-Annonce.
Chirurgien exceptionnel, le docteur Godwin Baxter est passé maître dans l’art de créer des êtres hybrides. Dans les caves d’un manoir victorien, il compose ses créations inhumaines. Lui-même victime des expérimentations de son père sur son corps, le docteur Baxter, créature et créateur, vit aux côtés de sa dernière création : Bella. Récupérant le corps de sa mère enceinte, après qu’elle a mis fin à ses jours en sautant d’un pont, le docteur a transféré le cerveau du nourrisson dans le corps de sa mère. Mue par l’envie dévorante de découvrir le monde, Bella s’évade en compagnie de Duncan, un avocat libertin, et part dans une aventure au terme de laquelle elle affrontera l’immondice de la société.
D’aventure en aventure, Bella gagnera la conviction qu’elle peut changer le monde. Se ralliant au socialisme et brisant le joug patriarcal qui enserre son désir, Bella choisira de nourrir un « amour pragmatique » et libéré avec Max, l’assistant du docteur Baxter qui surveillait ses progrès d’enfant. Si le conte s’arrêtait là, Lánthimos pourrait à raison se satisfaire d’un récit progressiste. Ajoutant à son film un quatrième acte superflu, il donne à son récit un dénouement contre-révolutionnaire : Bella, d’opprimée, deviendra un nouvel oppresseur et, imposant aux hommes de subir les mêmes sévices qu’ils lui ont infligés, continuera l’œuvre de son créateur Baxter, transformant son ancien mari en montre hybride dans les caves de son laboratoire secret. Désaveu cynique de la lutte pour l’émancipation, qui ne pourrait, à suivre Lánthimos, que se conclure sur la construction d’une société pire que celle qu’elle avait à abolir, le réalisateur succombe en outre à une exaltation déplacée de la femme forte et vengeresse qui confine à la caricature. Si le récit de Yórgos Lánthimos est riche d’opportunités manquées, il se conclut dans un éloge cynique d’une vengeance étrangère à la justice et reprend, de l’idéologie contre-révolutionnaire de la restauration bourgeoise, sa thèse principale selon laquelle la lutte révolutionnaire conduit nécessairement au totalitarisme.
Un conte philosophique en forme d’odyssée
Yórgos Lánthimos filme l’enfermement familial de la jeune créature du docteur Baxter. Inversant la dialectique de la créature et du créateur du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, l’expérimentation du docteur Godwin (nom de jeunesse de Shelley) resplendit d’une beauté qui fait défaut à son créateur, dont le visage défiguré ressemble à un collage chaotique de chairs agglutinées. Objet du désir de ses surveillants, Bella vit dans une prison taillée sur mesure pour satisfaire le regard masculin. Errant dans les couloirs du manoir, la caméra traque le corps de la jeune détenue. Adoptant la très courte focale (fisheye), Lánthimos donne à voir le regard inquisiteur du désir masculin et, jouant de la distorsion de l’image, dénonce en l’incarnant le préjugé patriarcal qui hante la représentation hollywoodienne du corps féminin, objet du « plaisir visuel » de la communauté du réalisateur et de ses spectateurs [1].
Cédant aux avances de Duncan qui promet à la jeune adolescente de satisfaire sa sexualité naissante, Bella s’évade de la prison familiale et s’embarque avec lui pour Lisbonne, première étape d’un long voyage. Mais cette aventure n’est que le prélude d’un nouvel enfermement, sous la tutelle patriarcale de son compagnon de route qui profite de sa naïveté pour faire de Bella le faire-valoir de son désir. Au dehors de la chambre de leur hôtel, où elle goûte aux plaisirs nouveaux de la sexualité, Bella découvre la ville et déambule dans ses ruelles baroques. Enlevée par Duncan, Bella poursuit son voyage sur un navire de croisière où elle rencontre ses premiers amis : une vieille femme que la sexualité désintéresse lui fait lire Emerson et Goethe tandis qu’un jeune homme lui expose les premiers axiomes de sa philosophie cynique. Refusant de croire que le monde ne peut être changé et que l’homme serait, pour jamais, voué à la cruauté, sans espoir de rédemption, Bella découvre néanmoins l’immondice de la société à l’occasion d’une escale dans une Alexandrie imaginaire où quelques bourgeois fortunés soupent sur la terrasse d’une forteresse tandis que les pauvres meurent dans des fosses à l’ombre de la ville haute.
La découverte de l’injustice dévoile la contradiction fondamentale de la société bourgeoise qui n’est, dans son essence, que le théâtre d’une « guerre civile longue et opiniâtre (eines Bürgerkriegs langwierigen) et plus ou moins dissimulée (mehr oder minder versteckten) entre la classe capitaliste et la classe ouvrière » [2]. Et c’est au fond dans ce passage du dissimulé au visible, que consiste la force de tous les récits d’initiation qui privent l’optimisme de ses droits et dénoncent, comme une supercherie sans nom, la thèse du meilleur monde possible.
Débarquée à Marseille avec Duncan, sans le sou, Bella et son compagnon, qui ne cesse de se montrer toujours plus odieux, montent à Paris où, pour subvenir à leurs besoins, l’héroïne fait le choix de se prostituer sans rien connaître du métier. Dans l’enceinte de la maison close, Bella s’étonne, naïvement, de cette opportunité nouvelle qu’elle y trouve de satisfaire à la fois ses besoins sexuels en même temps que son autonomie financière. Fréquentant prêtres, artisans, estropiés et hommes du commun, Bella approfondit avec une joie étrange son interminable leçon de choses, découvrant au bordel le spectre infini des plaisirs de la société bourgeoise. Après l’enfermement familial et la prison maritale, Bella fait l’expérience de la réclusion capitaliste. C’est ici que le récit voltairien emprunte le plus à Sade, ne serait-ce que par l’omniprésence de la question sexuelle, en raison du contraste saisissant entre la candeur érotique de la jeune femme et l’initiation à la sexualité patriarcale, des jeux fétichistes de certains clients à la domination brutale du corps féminin en passant par les cours d’éducation sexuelle que les bons pères de famille offrent à leur progéniture, afin de ne pas la laisser démunie quand viendra l’heure d’accomplir la chose.
Victime d’un triple enfermement, familial, marital et capitaliste, Bella est à la fois semblable au Candide de Voltaire et à la Justine de Sade : naïve comme Candide, elle parviendra à la connaissance du réel en traversant le monde qui ne cesse, comme Justine, de l’enfermer dans la cellule du désir masculin.
La naïveté révolutionnaire : contre Voltaire et contre Sade
Si le récit voltairien dit comment son héros passe de la candeur à la lucidité au cours des multiples épisodes de sa rencontre avec le monde, le récit sadien dit « l’infortune de la vertu », la succession des calamités qui marquent au fer rouge la chair d’une jeune femme sans ni lui ravir sa naïveté et ni lui donner la conscience de sa misère. Tandis que le récit voltairien sonne la fin du temps des illusions face à l’hostilité d’un monde que son personnage ne fait que traverser, le récit sadien refuse à sa victime son émancipation en l’enfermant dans l’éternel retour de l’injustice.
C’est au croisement de ces deux schèmes que le récit de Lánthimos trouve son équilibre : si Bella découvre l’immondice du monde bourgeois et parvient à le connaître en vue de l’abolir, à la Voltaire, elle habite néanmoins ses épreuves, à la Sade, et ne les dépasse dialectiquement qu’à donner à sa naïveté un caractère révolutionnaire. Tandis que le héros de Voltaire ne fait que survoler le monde au travers d’un voyage au terme duquel il aura compris son injustice constitutive, tandis que le personnage de Sade est condamné à subir sans changement un supplice infiniment répété, Bella habite son enfermement et le révolutionne en partie par la force vertueuse de la naïveté.
À Lisbonne, elle s’émancipe de l’emprise de Duncan, qui profite de sa naïveté pour l’utiliser à son bon plaisir, par la seule force de sa naïveté. Face au tourbillon indomptable de la liberté de Bella, Duncan tombe amoureux tandis qu’elle échappe à son contrôle. Dans la salle des fêtes de l’hôtel, Bella se lance ainsi dans une danse océanique et tumultueuse que son compagnon tente, désespérément, de transformer en une danse de salon avant de renoncer à réinscrire le pas effréné de la jeune femme dans les figures d’une chorégraphie mondaine.
S’engageant dans une maison close, lors de son séjour à Paris, Bella s’étonne qu’elle puisse satisfaire son désir sexuel tout en percevant une rémunération, voyant dans la proposition de la proxénète « un heureux signe du destin » alors qu’elle a besoin de sexe et d’argent (« I need sex and money »). Mais la violence des clients et le peu de plaisir qu’elle retire de ses passes lui font sentir cruellement son aliénation. Partageant son quotidien avec une autre travailleuse du sexe, qui se réclame du socialisme, Bella commence à réformer le bordel : révoltée par le rituel marchand au cours duquel le client choisit parmi les filles alignées, la jeune socialiste défend le droit des travailleuses à choisir celui avec qui elles s’uniront, sans trahir leur désir, et fait valoir que son corps est « son propre moyen de production » (« We are our own means of production »). Face à un autre client, elle lui impose de raconter un souvenir d’enfance et d’échanger des blagues, puis juge de son hygiène corporel avant de l’emmener au lit (« Now, I think we can fuck »).
Revenant à Londres après son long voyage, Bella retrouve son créateur qui lui révèle ses origines. Réconciliée avec le chirurgien gravement malade, elle épouse son assistant, Max McCandless, avec qui elle espère nourrir un « amour pragmatique », dans lequel l’affection ne succomberait pas à la jalousie et par lequel leurs corps échapperaient à l’idéologie propriétaire de la bourgeoisie.
Du conte à la parabole : le spectre de la morale contre-révolutionnaire
Mais les retrouvailles de la créature et de son créateur sont brusquement interrompues pendant la cérémonie de mariage. Accompagné par Duncan jaloux, l’ancien époux de sa mère, dont Bella a hérité de son corps, perturbe l’union et tente de reconquérir sa femme. Désireuse de connaître une nouvelle aventure, Bella accepte de le suivre jusque dans son palais, mue par une certaine curiosité à l’égard de l’homme qui a condamné sa mère au suicide. Le général lui confie qu’il partageait avec sa mère la même passion de la cruauté : torturant ses domestiques, feignant de lâcher son chien de chasse sur eux, l’ancien mari de la mère de Bella la confine à nouveau dans l’enceinte du foyer. Bella, forte de ce qu’elle nomme elle-même son « expérience », refuse de rester dans sa nouvelle prison tandis que le général la menace de l’exécuter si elle tente de s’enfuir et entreprend de l’exciser, jugeant que « ce qu’elle a entre les jambes » (what is between your legs) est la cause de son indocilité.
Tandis qu’il envisage de la droguer au chloroforme, Bella surprend la conspiration. En désarmant son bourreau qui lui impose de consommer le poison, elle lui tire une balle dans le pied et s’évade, en amenant le général à demi-conscient chez son créateur. Devant la réticence de Max qui refuse de soigner le général, de crainte qu’il ne renonce à son réveil à mettre son plan à exécution, Bella lui affirme qu’elle a l’intention de procéder à quelques améliorations sur son nouveau cobaye (I think he could benefit from some improvements). Le spectateur apprendra qu’elle a placé le cerveau d’une chèvre dans le corps de son ancien mari et qu’elle jouera de le garder, auprès d’elle, occupé à brouter les mauvaises herbes du jardin.
Mobilisant les tropes de la critique féministe du mariage patriarcal et de la haine du désir féminin, Lánthimos reprend en quelque sorte du début son ouvrage, redoublant la trame initiale de son film d’un commentaire qui l’explicite en même temps qu’il en appauvrit la grammaire visuelle : en couleur, cette reprise, à certains égards malhabile, cesse de jouer des variations de focale et dissipe le malaise qui régnait sur l’incipit. La forme n’est cependant pas la seule à pâtir de cette excroissance accolée à un récit qui jusqu’alors se déployait avec une certaine cohérence : l’ancienne créature se sait désormais le maître et, passionnée d’anatomie, reprend l’œuvre de son ancien bourreau. Elle se jouera des hommes comme ils se sont joués d’elles et, de créature confinée dans son enclos, deviendra la gardienne de son ancienne prison. Si Bella, au gré de ses aventures, qui empruntent tant à Voltaire qu’à Sade, avait imposé, au monde et aux hommes, l’inéluctabilité de son émancipation, elle prend désormais à cœur le rôle du maître. De l’opprimé à l’oppresseur un fil est donc tendu qui interroge sur le sens profond d’une œuvre qui s’était attachée à dire la libération du désir. Bien que Lánthimos revendique un cinéma iconoclaste qui prétend se refuser au tabou, cet immoralisme superficiel interroge.
S’il conserve de la topique du conte le retour de l’héroïne transformée à son point de départ, son odyssée de l’émancipation se conclut sur le constat cynique que l’opprimé a pris la place de l’oppresseur. Derrière l’iconoclasme, Lánthimos donne à son récit une morale contre-révolutionnaire : si l’idéal de la libération peut être loué comme un but abstrait, sa réalisation pratique aboutit à l’instauration d’une société encore plus autoritaire que celle dont il s’agissait de s’affranchir. Afin d’éviter le pire, il faudrait alors se contenter de l’ordre présent des choses et saisir la nature utopique de tout espoir d’en abolir ne serait-ce que le moindre de ses éléments les plus odieux. Ce dénouement réactionnaire trouve dans la scène finale sa représentation la plus terrifiante : allongée sur sa chaise, la nouvelle démiurge lit aux côtés de ses nouveaux esclaves, dans un jardin où cohabitent ses domestiques, son mari transformé en chèvre et sa nouvelle créature, assemblée sur la table d’opération dans les caves du manoir. Si la critique a parfois souligné le caractère féministe des Pauvres Créatures, il semble qu’elle ait manqué le cynisme contre-révolutionnaire qui travaille son dénouement.
Déjà dans The Lobster, Lánthimos trahissait son préjugé conservateur : filmant les pensionnaires célibataires d’un centre dans lequel ils devaient retrouver l’amour sous peine d’être transformés en animaux, le réalisateur s’attardait sur la contre-société formée par ceux qui s’en étaient échappés. Dirigé par une leader impitoyable, le monde de la résistance n’était que le reflet négatif de l’ordre de l’oppression. Tandis que les pensionnaires ont à trouver l’amour sauf à payer leur célibat de la mort, les résistants (les « lonelers ») doivent rester solitaires et sont sévèrement punis s’ils nouent des relations qui dépassent la politesse polie et froide d’un compagnonnage distant. À la société de l’union forcée, Lánthimos opposait ainsi une communauté de l’anti-solidarité.
Une carricature du féminisme
Si les Pauvres créatures ne donnent pas à ce manichéisme cynique une dimension tragique, elles ne se concluent pas moins sur le rétablissement d’un nouvel ordre de la domination, né de l’idéal même de la liberté. Ce n’est, à cet égard, pas un hasard si Lánthimos fait dire à son personnage, qui se déclare « socialiste » lors de ses mésaventures parisiennes, qu’elle croit à « l’amélioration de l’homme » et qu’elle refuse de le réduire à sa simple cruauté. Lui opposant son irréfragable corruption, Lánthimos trahit, sous son attirance formelle et iconoclaste pour la violence, un puritanisme qui fait des vieilles lunes de l’anthropologie bourgeoise son plus durable fond de commerce : parce que l’homme est mauvais, il ne sera jamais libre, condamné à n’être pour toujours qu’une chose maudite (« Poor Things »). L’audace aurait commandé d’inverser les termes de cette hypothèse : parce qu’il n’est pas déjà libre, l’homme est encore mauvais.
Les lectures féministes de Lánthimos inquiètent également, en raison de la fascination dont elles font preuve pour la toute-puissance retrouvée de cette « Barbie victorienne qui jouit sans entraves » [3]. Alors que Bella déclarait, à son retour à Londres, son attirance simple et sincère à l’égard de Max, l’assistant du docteur Baxter, et louait leur « amour pragmatique », le soudain retour du mari de sa mère, Victoria, dont Bella a hérité du corps, fait du film un récit de vengeance : du conte philosophique à la rétribution justicière, le film s’achève avec une froideur troublante dans la joie de l’expiation, au grand plaisir de la salle où la brutalité de Bella, nouvelle créatrice de monstres, a déclenché quelques éclats de rires. Et lorsqu’il ne cède pas au cynisme, Lánthimos excite néanmoins une jouissance inquiétante pour la vengeance d’une femme devenue forte, capable de faire subir à ses anciens bourreaux ce qu’elle a elle-même subi, et achève son conte philosophique dans une carricature de féminisme.
Sacrifiant la justice sur l’autel de la vengeance, Lánthimos défend cette thèse profondément idéologique selon laquelle notre liberté n’est au fond que la servitude d’un autre et, réduisant l’ensemble du cheminement de son personnage au simple dilemme de la mysogynie et de la misandrie, Lánthimos manque l’écart, qu’il effleure pourtant un instant du doigt, d’où se provoque cet « amour pragmatique » qui rompt tant avec l’amour-propriété, que dénonce Bella, qu’avec les formes punitivistes de la justice bourgeoise. Car cet amour pragmatique, avoué sous le soleil de Londres, au détour d’une promenade sur les berges de la Tamise, faisait à la fois droit à la liberté sexuelle de Bella, au plaisir dont elle reprochait à Duncan de la priver par égoïsme et jalousie et à l’épanouissement paisible des sentiments de son futur mari. Sa survenue est aussitôt dissipée par l’appel du sang.
C’est là toute l’ambiguïté de ce mot que Bella ne cesse de revendiquer, elle, qui rêvant d’« aventure », désirait faire des « expériences » où le spectateur entendra à la fois l’apprentissage de la vie, les expérimentations monstrueuses de Bella et de son créateur et les plaisirs de la sexualité. Au fil du récit, Lánthimos procède à la compaction de ces trois sens et ne donne au récit de l’émancipation féminine, pour tout dénouement possible, que celui de la volonté de pouvoir. Qu’il s’agisse de la jouissance déplacée pour la vengeance sans justice de l’opprimé ou du récit contre-révolutionnaire d’une émancipation qui ne pourrait s’achever qu’à rétablir une domination alternative, Lánthimos déçoit ce qui fait la force esthétique de sa proposition initiale : un conte philosophique sur la libération de la femme et du désir qui n’avait pas nécessairement à se conclure sur le spectacle macabre d’une révolution trahie.
[1] Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, 1 septembre 1975, vol. 16, no 3, p. 6‑18.
[2] Karl Marx, Le Capital, in Œuvres I : Économie, Paris, Gallimard, 1994, I, iii, vi, p. 833.